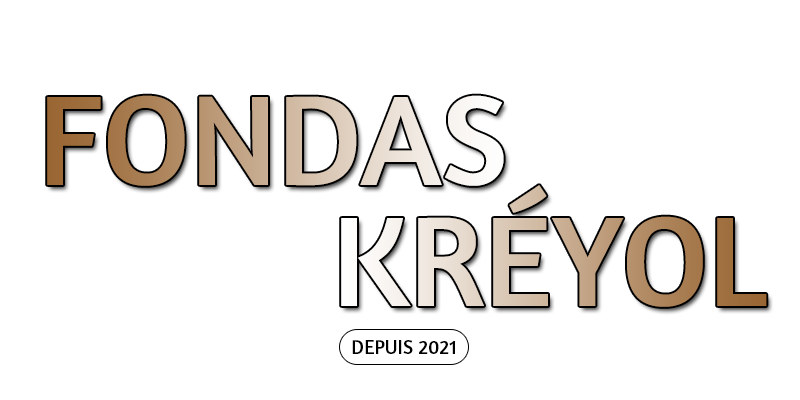À propos de « l’écovillage » de Ducos. Une tribune de l’architecte Gustavo Torrès

- Et jusqu’à quand pensez-vous qu’on peut continuer dans cet aller et venir de fous ?
Florentino Ariza avait la réponse toute prête depuis cinquante-trois ans, sept mois et huit jours avec ses nuits.
Il dit alors :
- Toute la vie.
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 1967.
« Écovillage » : un doux euphémisme pour un vieux modèle
Vous êtes encore là, vous, à bâtir des zones ? Déjà pour la Galleria, on nous disait que c’était « ma ville à moi »… Il ne faut jamais oublier que les vautours avancent toujours masqués, usant d’un vocabulaire convenable enveloppé d’euphémismes flatteurs. Dire aujourd’hui « écovillage » n’est qu’une édulcoration malhonnête pour recommencer ce qu’on fait et refait depuis soixante ans : une zone commerciale entourée de parkings sur un terrain soi-disant vague.
60 ans d’urbanisation à l’horizontale : un choix destructeur
Depuis l’arrivée des « architectes des colonies » dans les années 1930 — envoyés pour nous vendre le modernisme et le béton armé —, puis après-guerre avec la départementalisation, la Martinique subit passivement les injonctions spatiales de la mère-polis. Nous avons participé au saccage sans pitié du maigre territoire dont nous disposons. Notre entrée volontaire dans l’assimilation, censée nous sauver de la misère, nous a certes apporté l’opulence — si, si — mais la plus bête d’entre toutes : celle de la société de consommation.
Le mythe de la modernité : béton, zonage et gaspillage
La modernité qui s’en est suivie nous a apporté son lot dogmatique pour l’aménagement de l’espace, puisé dans la Charte d’Athènes de 1933 et les idées simplistes de quelques architectes maîtres en communication. Habiter, travailler, se détendre : ces activités ont été isolées les unes des autres, parquées dans des zones monothématiques reliées par le réseau sacré de la circulation automobile.
Un modèle à bout de souffle : inadapté à un territoire fini
Ce modèle, infantile mais dominant depuis la reconstruction d’après-guerre, repose sur l’idée folle que l’espace serait infini. Comme le mythe d’une planète aux ressources inépuisables. Le résultat ? Des zones utilisées un tiers du temps seulement, des infrastructures gaspillées, des investissements dilapidés. Pour un territoire de 1 000 km², dont une large part est inconstructible, ce n’est plus de la bêtise, c’est de l’irresponsabilité.
Trois mamelles et zéro mixité : la trinité funeste du bâti martiniquais
Depuis les années 1960, nous anthropisons notre île à l’horizontale, nourris du lait des trois mamelles de notre boîte à outils : les lotissements, les zones (artisanales, commerciales, industrielles…) et les cités HLM. Ce modèle s’est doublé d’une spécialisation des opérateurs : les uns font du collectif, les autres du pavillonnaire, d’autres encore du commercial. Aucun ne pense ni ne pratique la mixité.
Quand la ville savait encore penser la complexité
La ville, depuis longtemps, avait pourtant su inventer la superposition des usages. Non seulement pour rentabiliser l’espace et les investissements, mais surtout pour répondre à la complexité sociale. Une cohésion urbaine démantelée par la bourgeoisie du XIXe siècle, ses sulkys, ses ascenseurs et son goût pour l’entre-soi méprisant.
Fort-de-France en exemple : la périphérie a tué le centre
Aujourd’hui, la propagande fait croire que le bonheur réside dans une villa avec piscine, en lotissement. Mais c’est un mensonge devenu intenable. Construire une nouvelle zone commerciale alors que le bourg se dessèche est de la paresse intellectuelle et de la cupidité. Regardez Fort-de-France, vidé de ses fonctions par l’urbanisation périphérique et les lotissements abscons.
L’urbanisme individualiste contre la société collective
Chaque zone spécialisée, chaque lotissement isolé, chaque cité construite « au milieu de nulle part » est un assassin silencieux des bourgs. Et l’isolement imposé par ce modèle encourage le délitement social. Le vivre-ensemble se disloque dans cette organisation spatiale, miroir du modèle consumériste individualiste.
La démission des institutions d’aménagement
Quant à la mairie, elle se cache derrière la réglementation… qu’elle a elle-même façonnée. La DATAR ne nous envoie plus de plans annuels. Le SAR et le SMVM sont abandonnés, les SCOT non suivis. Restent les PLU, externalisés à des bureaux d’études sans vision globale. Il n’y a plus de pensée partagée, plus de coordination. Seulement des intérêts strictement municipaux.
Des maires au pied du mur : sortir de la logique micro-territoriale
La Martinique n’a plus de structure politique globale. Son avenir est entre les mains de maires devenus roitelets de micro-territoires. Ils doivent sortir de cette satisfaction clientéliste, élargir leur horizon, imaginer une vision commune de l’espace insulaire.
Une nouvelle éthique de l’espace : frugalité, sobriété, mixité
Comme pour l’exploitation des ressources naturelles, il est temps d’arrêter la fuite en avant. Il faut adopter une logique de sobriété, de frugalité, de respect de l’espace. Apprendre à produire et consommer moins, mais mieux. Et cesser de vivre comme des enfants gâtés.
Réinventer la ville martiniquaise : verticale, plurielle, solidaire
Il nous faut réinventer la ville : complexe, plurielle, ouverte. Créer des hangars pour les artisans, des galeries pour les commerces, des bureaux, mais les mêler à des logements divers, des écoles, des espaces publics. Oser la verticalité. Les opérateurs devront s’adapter. Mais nos enfants nous remercieront.
Par Gustavo Torres, architecte
(Les intertitres sont de la Rédaction Antilla.)
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 119 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
30/01/2026 - 10:43
Valérie Parlan ("Ouest-France")
15/12/2025 - 19:43
Commentaires récents
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Albè, déjà...
Frédéric C.
31/01/2026 - 11:48
...Le mot "race" est-il pertinent? NON. Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
DANS LE CORAN...
Albè
31/01/2026 - 09:07
...Mahomet dit : "L'arabe est une habitude de la langue et qui donc parle arabe est un Arabe". Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Albè, il est possible qu’@Lidé rebondisse...
Frédéric C.
31/01/2026 - 08:05
...seulement sur le terme que j’ai utilisé pour parler du Maghreb. Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
METISSAGE ?
Albè
31/01/2026 - 05:35
Il n'est nulle part question de "Métissage" dans l'article que vous commentez !!!
Lire la suite« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
le metissage n'est pas une solution!
@Lidé
31/01/2026 - 03:15
En europe on dit arabe pour tout, mais il à eu peu d'arabe au Magrebh.
Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Un artisan pierrotin juge l'évolution de sa ville
- « Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
- Bòbò, manawa, machapia, volpòn… Es mo-kolokent sé van?
- Qui prétend que la langue créole est pauvre du point de vue du vocabulaire ?
- L’AOC de NEISSON menacée de mort
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus