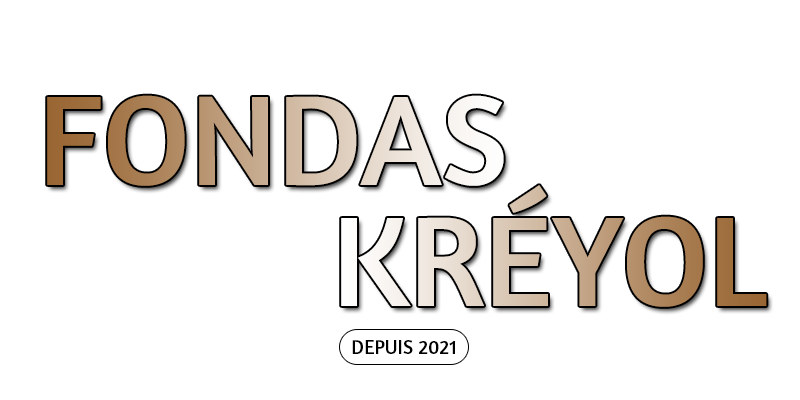Un regard nouveau sur la diglossie français-créole. Esquisse d’une approche écosystémique des langues

Il semble important de rénover la vision traditionnelle de la diglossie aux Antilles en tenant compte à la fois des données écosystémiques et des aspirations identitaires. C’est à ce prix que, scientifiquement informées, l’ensemble des communautés créolophones pourra remplacer le duel idéologique créole-français par un duo fonctionnel, fonctionnant donc sur une base de coopération, et définissant ce qu’il est convenu d’appeler un colinguisme.
Introduction : rappel préliminaire
1) La situation paradoxale des créoles historiques
2) Vers une approche systémique de la relation créole-français
Une approche écolinguistique
Une approche sociolinguistique
3) Rappels des effets idéologiques socioculturels, symboliques et psychologiques de la diglossie
4) La diglossie dans tous ses états
État I
État II
5) Écolinguistique et pédagogie en milieu de diglossie français-créole
Conclusion
Texte intégral
Introduction : rappel préliminaire
1Il convient de rappeler que, contrairement à la vision fixiste du sens commun, l’hétérogénéité et la variation constituent les modalités ordinaires des langues, lesquelles sans cela ne se transformeraient pas. En sorte que même des situations répertoriées le plus officiellement du monde comme monolingues sont en fait, parcourues par les effets de ces deux caractéristiques. Il y a lieu, en effet, au-delà du niveau interlinguistique, de repérer le niveau intralingual. L’existence, par exemple, d’un objet appelé franglais est une illustration de la dynamique intralinguale car le franglais c’est aussi bien le résultat de la pénétration de l’anglais dans le français que le résultat de la pénétration du français dans l’anglais. Il est évident qu’une telle dynamique intralinguale trouve son origine dans le phénomène de mise en contact de deux ou plusieurs langues (intralinguistique). La mise en contact des langues et des cultures ne peut qu’être accélérée, amplifiée par la mondialisation des réseaux modernes de communication.
2Nés du contact des langues diverses inscrites dans les processus de colonisation, les créoles sont le résultat de mécanismes localisés (par exemple, dans la Caraïbe ou l’Océan Indien). Il y a donc lieu de distinguer une créolisation passée qui a produit les langues créoles historiques existant à ce jour et une créolisation en cours qui est le résultat d’une mise en relation non plus localisée mais généralisée (à l’échelle planétaire) de systèmes linguistiques et culturels les plus divers. Cette créolisation est perpétuellement en train de produire de nouveaux systèmes dont la configuration globale nous échappe par manque de recul. L’analyse des créoles historiques dans leurs dimensions linguistiques et culturelles définit – rappelons-le – la discipline, dénommée créolistique. La créolistique est précisément de nature à nous éclairer sur les mécanismes en cours dans le procès de mondialisation des interactions humaines. Une telle assertion constitue l’un des fondements théoriques du mouvement littéraire et culturel dit « mouvement de la créolité » et dont l’essai intitulé Éloge de la créolité (J. Bernabé, P. Chamoiseau, R. Confiant, 1989) fait figure de manifeste.
1) La situation paradoxale des créoles historiques
3Revenons aux créoles historiques, plus particulièrement les créoles dits à base lexicale française de la zone américaine. Parmi eux, je m’intéresserai ici à ceux de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Sainte-Lucie, Dominique, Grenade, Trinidad (les quatre derniers étant depuis la fin du XVIIIe siècle ou le début du XIXe siècle en contact avec l’anglais, le français ayant complètement disparu de ces territoires). Les créoles sont, par nature et par vocation, des langues mixtes. De cela, découle une particularité selon laquelle, dans l’environnement immédiat d’un créole, existe obligatoirement une langue standard de grande diffusion avec laquelle il entretient des rapports de répartition fonctionnelle, ce que les linguistes ont caractérisé à l’aide du mot diglossie (Ferguson, 1959). Ce mot est différent du mot bilinguisme en ce qu’il implique toujours la dimension collective et sociale du rapport inégalitaire des langues là où le bilinguisme s’intéresse soit à l’aspect individuel soit à l’aspect social de ce rapport, pas nécessairement inégalitaire. Cette inégalité tient au fait que le français peut occuper tout l’éventail communicatif (c’est-à-dire la zone « basse » et la zone « haute ») tandis que le créole est confiné dans la zone basse correspondant aux emplois non formels de la langue. Rappelons que, dans la terminologie de Bickerton (1973), la notion de langue « basse » est exprimée par le mot basilecte, le terme acrolecte désignant la langue « haute ».
4La diglossie peut être bi-polaire, concernant la relation français-créole comme à la Martinique et à la Guadeloupe ou, au contraire, multipolaire, concernant un pays comme la Guyane où des rapports croisés et multiples s’établissent entre les langues suivantes : créole, français, langues amérindiennes, elles-mêmes nombreuses, sranan tongo, portugais du Brésil. Il apparaît avec évidence que, dans l’espace Antillo-Guyanais, le multilinguisme constitue une réalité très prégnante. Or ce multilinguisme propre à l’ensemble du corps social se trouve battu en brèche par une tradition scolaire essentiellement monolinguistique dans son idéologie, ses démarches didactiques et son projet socio-éducatif. Là est la marque la plus évidente – et la plus décriée par certaines élites – du mécanisme sociologique de la diglossie, mécanisme au terme duquel le français fonctionne comme langue dominante au service d’une culture dominante et pénalise la langue et la culture créoles en les maintenant à un niveau de mal-développement préjudiciable à l’identité de leurs locuteurs et ressortissants.
2) Vers une approche systémique de la relation créole-français
5La relation entre créole et français peut être pensée sous un angle purement intellectualiste de nature purement contrastive (ou comparative). Cette approche rend possible la mise en place d’une diasystème créole-français aux plans tant phonologique que syntaxique, lexical, sémantique ou stylistique. Toutefois on ne peut faire l’économie d’une approche fonctionnelle et réaliste du rapport unissant ces deux langues. Dans ce cas, il apparaît avec évidence que ces langues appartiennent au même biotope linguistique, qu’elles relèvent du même écosystème. Et si les langues sont des espèces vivantes, on peut alors légitimement réfléchir sur leur mort, leur survie, leur étiolement, leur renaissance, etc. Nul n’ignore, en effet, que le latin, maintenant langue morte, fut la langue du très puissant empire romain, ce qui ne l’a pas préservé d’une élimination-substitution par les langues romanes.
6Hall (1966) présente le processus de décréolisation comme étant inexorable et devant déboucher à terme sur un continuum entre le créole et sa langue-mère. Les facteurs mis en cause relèvent chez Hall du domaine de la sociologie du langage.
7Il a été mis en évidence (Bernabé, 1989) les règles écolinguistiques qui sous-tendent le rapport des langues dans les Petites Antilles. Elles se ramènent au principe suivant : deux langues ne peuvent partager la même niche écologique sous peine d’élimination pour l’une d’elles (la plus faible). Ce principe, formulé autrement, devient : deux langues ne peuvent pas occuper indéfiniment le même créneau fonctionnel. Tôt ou tard l’une d’entre elles est éliminée. Cela tient au fait que la langue génère un déroulement discursif linéaire dans le temps et qu’il est, de ce fait, impossible de parler en même temps deux langues. Tel est le fondement des deux mécanismes interlinguistiques que sont le code switching (alternance de code, étant entendu que l’alternance peut être intra ou inter-phrases, intra ou inter-énoncé) et le code-mixing (mélange de code), qui d’ailleurs aboutit à un troisième code. Poussé à son extrême limite, le code switching peut aboutir à l’effacement d’un des deux termes de l’alternance, ce qui a pour effet précisément de supprimer toute alternative et de provoquer, par conséquent, l’élimination d’une des langues. Il s’agit, peut-on dire métaphoriquement, d’une panne dans l’alternance. On sait qu’il y a des créoles morts (comme à Grenade), moribonds (comme en Louisiane ou à Trinidad), en crise (comme à Sainte-Lucie ou à la Dominique). Cette disparition des créoles illustre ce qu’on pourrait appeler une décréolisation quantitative, c’est-à-dire touchant le nombre des locuteurs d’un créole donné.
8Poussé à son extrême limite, le code-mixing, quant à lui, peut aboutir à l’élaboration d’une langue tierce, d’une langue mixte. Mais cette langue mixte, par effet d’optique, apparaît comme le prolongement d’une des deux langues en contact. Il convient, en effet, à cet égard de rappeler que le franglais est, selon l’angle de vision, soit un français anglicisé, soit un anglais francisé. Ce que l’on peut appeler décréolisation qualitative n’est autre que le mécanisme de code-mixing au terme duquel la langue créole se francise, et subit, de ce fait, une mutation dans sa nature, sa « qualité linguistique ». Dans les Antilles françaises, la langue créole subit une très forte décréolisation qui est, par la même occasion, une francisation ; mais cette langue n’a jamais été aussi vivante, fournissant quotidiennement des volumes de parole de plus en plus importants, et ce, notamment avec la libéralisation intervenue, dès 1983, dans le paysage audiovisuel français.
9La disparition du créole, là où elle s’est produite (Grenade par exemple où il n’existe pratiquement pas de locuteurs âgés de moins de 60 ans), n’est donc pas imputable au français ou à l’anglais, langues avec lesquelles il est respectivement en distribution complémentaire, dans le cadre de la diglossie classique. Elle est imputable au fait que d’autres langues se sont développées sur la même niche que le créole à base française : c’est en effet le créole à base anglaise qui, occupant la zone basse du système, a éliminé le créole à base française de la Grenade tout comme le français en avait été éliminé par l’implantation de la langue anglaise dans le créneau fonctionnel de langue haute (formelle et administrative). Donc, dans un cas, lutte pour le créneau fonctionnel de la langue basse (dans ce cas, élimination de la langue la moins forte) et dans l’autre cas, lutte pour le créneau fonctionnel de la langue haute (élimination également de la langue la moins forte). La notion de fonction est une notion polymorphique qui opère selon des modalités et des contenus qui ne sont lisibles que dans le cadre de l’écosystème donné. Ici la fonction pourra être socio-symbolique, ailleurs, économique ou politique.
10On le comprend aisément : il y a lieu de distinguer deux approches de la réalité des langues :
Une approche écolinguistique
11Celle-ci envisage des données factuelles et des règles de substitution-élimination (sur le court terme) ou d’ingestion-transformation définissant dans ce dernier cas une zone linguistique intermédiaire appelée interlecte, et qui renvoie à la notion de glottophagie (Calvet, 1974). Cette zone interlectale peut à son tour gagner du terrain et occuper des créneaux où elle éliminera l’une des deux langues. Cela définit un mécanisme d’élimination sur le long terme. C’est ainsi que le latin s’est mué en langues romanes (français, espagnol, italien, roumain, etc.)
12De tout cela, il ressort que la diglossie est porteuse de stabilité (d’homéostasie) et est relativement conservatoire quant à la préservation des espèces de l’écosystème. Autrement dit, quand chaque langue reste dans son créneau fonctionnel, il existe une cohabitation qui peut être plus ou moins conviviale des langues en présence. Mais les créolophones souhaitent-ils maintenir cette répartition fonctionnelle ? L’existence de plus en plus intense du créole sur les médias semble bien être le signe du contraire.
Une approche sociolinguistique
13La dimension sociolinguistique génère diverses représentations sociopolitiques et idéologiques (offertes d’ailleurs à l’action militante). La diglossie a mauvaise presse auprès de militants politiques et culturels, soucieux de mettre un terme à la minoration de la langue créole qui est aussi, par là même, la dévalorisation d’une langue et de la culture qui y est attachée, ainsi que des communautés qui la pratiquent.
3) Rappels des effets idéologiques socioculturels, symboliques et psychologiques de la diglossie
14Au terme de la diglossie, la valorisation de la langue française est, rappelons-le, génératrice de la dévalorisation corrélative du créole. Le français n’a pas seulement de la valeur, il est une valeur, il est même la valeur par excellence autour de laquelle s’ordonne l’expérience sociale dans son ensemble.
-
Vecteur du savoir et du pouvoir, le français est aussi le convoyeur de l’imaginaire lié à ce savoir et à ce pouvoir.
-
Instrument exclusif de l’École (donc de la promotion sociale), malgré diverses circulaires ministérielles sur les langues et cultures régionales de 1982 (circulaires Savary), le français fonctionne comme langue et métalangue exclusives.
-
Ce statut de la langue française en fait, à la limite, moins un instrument de communication qu’un instrument de communion au sens magique et religieux du terme. Dans nos pays, le français n’est pas seulement langue, il est aussi religion. Il n’est pas seulement un objet culte, il est aussi un objet de culte, l’objet d’un culte, d’une révérence, voire d’une vénération.
-
La non-participation à sa sphère d’influence est en soi une exclusion et, disons-le, avec ou sans métaphore, une manière d’enfer. Cela signe le statut de la langue française aux Antilles à l’intérieur d’un système où elle est opérateur d’exclusion à moins de devenir un instrument d’assimilation forcenée, si on ne veut pas être hors-jeu de la langue française et des valeurs socio-culturelles que, en situation coloniale, elle prône.
-
Qui dit assimilation forcenée dit aussi, par la même occasion, déclenchement de processus de compensation, voire de surcompensation. La relation au français s’est donc développée dans nos pays sous le signe de l’exagération, de l’hyperbole, de la boursouflure, du chiqué, de l’affectation, de l’emphase, de l’amphigouri.
-
Cela a contribué à situer prioritairement et pendant longtemps l’activité langagière des Antilles non pas tant dans la sphère du rationnel et du réalisme que dans celle de l’émotionnel et de l’idéalisme. Non pas tant dans la sphère du descriptif et de l’argumentatif que dans celle du lyrisme énonciatif. Non pas tant dans la sphère du dialogue et du processus inter-énonciatif (le relationnel) que dans celle de l’ontologie (l’absolu), non pas tant dans la sphère de la communication que, rappelons-le, dans la sphère de la communion. Le schéma (fusionnel) de la communication s’en trouve quelque part faussé entre un parleur (volontiers beau parleur) et un écoutant perpétuellement figé dans le rôle de l’écoutant, c’est-à-dire du muet. En sorte que, à la limite, le français s’administre à l’école à un muet, à un élève atteint d’un mutisme sélectif et dont ne viennent pas à bout tant et tant d’efforts pédagogiques.
15On pourrait continuer à décliner les effets – considérés comme pervers – de la diglossie. On ne saurait y remédier en adoptant une réaction idéologique et non informée par une réflexion en profondeur sur les données systémiques que j’ai précédemment initiées.
16Aucune pédagogie digne de ce nom ne devrait, en pays de diglossie créole/français, faire l’économie de cet aggiornamento que j’appelle de mes vœux.
4) La diglossie dans tous ses états
17Il importe cependant de ne pas tenir un discours simplificateur sur la diglossie. Toutes les diglossies ne se ressemblent pas dans l’espace et n’induisent pas les mêmes effets. Par exemple, la diglossie anglais-français au Québec ne saurait avoir les mêmes implications que la diglossie français-créole pour la simple et unique raison que, si le français est en position d’infériorité au Québec, il est partout ailleurs en position dominante, tandis que le créole est partout, où il existe, en position dominée. Les implications sociosymboliques ne sauraient être les mêmes ici et là.
18De même, dans le temps, il y a lieu, pour une même relation diglossique, de faire intervenir les paramètres appropriés. C’est ainsi que deux paramètres tels que la source sociale des langues (langue cultivée vs langue populaire) et le canal de leur diffusion (uni-canal vs multi-canal, écrit vs oral, etc.) dans l’écosystème doivent particulièrement être pris en considération. Aussi à l’aide de ces deux variables, il est possible d’identifier deux états de la diglossie français-créole aux Antilles-Guyane :
État I
19Marqué à l’origine par une source sociale « langue populaire » liée à une diffusion uni-canale non véhiculée par les médias à longue portée (il s’agit, en effet, du bouche-à-oreille), le français s’est répandu dans nos pays parce que des francophones le parlaient indépendamment du cadre scolaire. Mais l’École (réservée tout d’abord à une élite puis ouverte en raison des lois Jules Ferry à une masse de plus en plus importante) n’a fait que renforcer la domination de la langue dominante en se constituant comme pôle de référence du français, c’est-à-dire du « français cultivé », du « bon français », par opposition avec le français populaire de France et le français créolisé. Le système scolaire est donc devenu le véhicule privilégié de la langue française, développant dans les faits une stratégie à visée monoglossique. Nous avons affaire à l’état I que je qualifierais de diglossie flamboyante ou (diglossie classique) et qui correspond aux effets que j’ai précédemment signalés : la « cote » de la langue française est élevée et celle du créole au plus bas. Cette situation est celle qui a généré le français local ou français créolisé.
État II
20Cet état est marqué, pour ce qui est du français, en plus de la source sociale « langue cultivée », par la source sociale « langue populaire » laquelle est véhiculée, cette fois, par une diffusion multicanale portée par les médias de masse, qui, en plus de l’École, correspond à un paysage audiovisuel particulièrement renforcé depuis 1983 et en liaison directe – pour des durées de plus en plus importantes – avec le centre d’émission hexagonal. Cela entraîne une émergence sans précédent du français hexagonal (le « français de France ») dans le paysage linguistique de nos pays. En sorte que, en plus du créole, du français scolaire et du français local, il y a une autre espèce qui s’installe : le français de France (conformément à l’expression « la France en direct » qui sert de titre à une méthode de français langue étrangère). L’influence de ce français de France se manifeste à un certain nombre d’indices dont, par exemple, la chute du e caduc, phénomène perçu, il y a encore une quinzaine d’années comme une caractéristique d’affectation (palé bwodé signifiant « parler affecté »). Cela indique, à tout le moins, une sorte de banalisation du « français de France », marqué dans les représentations symboliques locales, par la chute de ce e caduc.
Ex : j’t’assur’ que j’vais y aller
au lieu de
je t’assure que je vais y aller.
- 1 Ce mot-valise désigne le créolophone ayant vécu en France et mettant en œuvre, de ce fait, des pra (...)
21On peut aussi noter la multiplication de phatèmes tels que bon ben, eben dis donc etc. Là encore on a affaire à des traits qui, il y a une quinzaine d’années, constituaient la marque d’une pratique « négropolitaine »1.
22En d’autres termes, les données systémiques de la diglossie sont en train de changer considérablement, et on pourrait bien se retrouver dans une situation où le « français populaire » serait en position de concurrencer le créole dans le créneau fonctionnel de la langue basse, et cela avec d’autant plus de force que le mécanisme est alimenté depuis le centre avec tout le prestige symbolique et la puissance imaginaire que représente, en contexte de domination culturelle, la Métropole. En sorte que, au point de vue écosystémique, l’adversaire du créole serait non plus le français scolaire mais la variante basse du « français de France », lequel est en mesure de s’agréger au « français local » qu’il renouvellerait de l’intérieur, en en amplifiant l’emploi. Une donnée à cet égard est symptomatique : dans le cadre de la diglossie classique (état I) la compétence du français au moins substandard était une condition pour qu’un locuteur soit considéré comme alphabétisé. Par contre, dans l’état II de la diglossie, on rencontre des locuteurs non alphabétisés (victimes d’illettrisme) qui ont, à l’oral, des productions qui attestent donc d’une compétence de ce que l’on pourrait appeler un « français basique standard », lequel ne ressortit pas au « français local ». Il est d’ailleurs à noter que la langue française tend de plus en plus à intervenir comme modèle maternel proposé à la maison aux enfants des milieux ruraux. Il s’agit bien évidemment d’un français créolisé ou français interlectal.
23On ne peut occulter la problématique de l’interlecte (Prudent, 1980) comme instance intermédiaire entre français et créole et dont le statut est tel qu’il nourrit une perpétuelle ambiguïté quant à ses fondements, sa démarche et ses objectifs. L’interlecte, promu à un destin littéraire, anime les œuvres du mouvement de la créolité comme en témoigne l’essai Éloge de la créolité (Bernabé, Chamoiseau, Confiant, 1989). Problématique passionnante et d’actualité que celle de l’hybridation littéraire du créole et du français pour rendre compte de la complexe réalité de nos pays. Sans fuir une telle problématique, je ne fais ici que la suggérer. Je voudrais surtout insister ici sur les aspects pédagogiques de la réalité générée par la dimension écolinguistique indiquée précédemment.
5) Écolinguistique et pédagogie en milieu de diglossie français-créole
24Le problème n’est assurément pas – on l’aura enfin compris – d’être pour ou contre la diglossie, même si la diglossie est un bilinguisme inégal et dont la pérennisation est précisément liée à cette inégalité, elle-même génératrice de distribution complémentaire, donc d’apartheid, de répartition de zones d’influences.
25Le problème est de savoir s’il est possible, et comment il est possible, de mettre en œuvre les stratégies réalistes visant, à partir des données objectives de la diglossie,
-
à promouvoir les langues et cultures créoles au sein de l’École, c’est-à-dire, sur le terrain propre au français, sur sa niche écologique à lui. Cela est-il possible sans dommage pour le créole ? et s’il y a un prix à payer, quel est-il ?
-
à mettre en œuvre une interaction et une coopération entre les deux sphères linguistiques et culturelles du français et du créole de façon à identifier les contrastes et les homologies, les divergences et les convergences, les jeux et les enjeux.
26Il semble évident, à partir des analyses écolinguistiques précédentes, qu’il convient à tout prix d’éviter d’assigner (dans un premier temps tout au moins) à l’enseignement des savoirs liés à la sphère créole la même fonctionnalité qu’à l’enseignement des savoirs liés à la sphère française. Si ce souci n’était pas respecté, à terme la pédagogie du créole se trouverait minorée puis éliminée par la pédagogie du français, plus efficace au sein d’une École soumise aux dures lois de l’économie.
27Il faut assigner à la pédagogie du créole des objectifs qui ne soient pas mineurs mais qui ne cherchent pas à concurrencer la pédagogie du français. Pendant longtemps des pédagogies en rupture de ban, voyant l’échec du système lié au français, ont mis en œuvre la transmission des contenus identiques avec simple changement du médium (on remplaçait le français par le créole). Si cela, sur le plan de la contestation politique d’un système hégémonique, peut avoir une signification, cette signification ne saurait s’ériger en doctrine didactique digne de ce nom. En bref, enseigner la physique en créole serait, aujourd’hui, une aberration fonctionnelle. Cela ouvrirait, en effet, la voie à une francisation encore plus poussée du créole.
28Il conviendra de repérer ce que la langue créole, au moment de son introduction dans le système, peut prendre en charge sans singer la pédagogie du français et sans risquer d’être structurellement phagocytée (décréolisation) par la langue française. Quel intérêt le créole aurait à converger vers le français au point de devenir du français + epsilon ? Est-ce que du point de vue économique et géopolitique il n’y aurait pas alors plus de profit à ne recourir qu’au français dans un tel cas ? Ne serait-ce pas payer cher le goût de la différence pour la différence ?
29Il convient, d’autre part, d’affirmer que l’introduction du créole à l’École ne saurait avoir de pertinence en dehors de son introduction préalable au niveau le plus élevé : le niveau des diplômes universitaires. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre un diplôme qui comporterait un ou des modules de créole, mais d’un diplôme de créole en formation initiale (licence et maîtrise, par exemple). C’est dans cette perspective qu’il a été demandé et obtenu à la Faculté des Lettres pour 1994-1995 la création d’une licence de langues et cultures régionales et en 1995-1996 d’une maîtrise de langues et cultures régionales. L’esprit de ces formations en dit long sur les stratégies utilisées, et qui se présentent avec les précautions suivantes :
-
Non pas séparation d’avec les disciplines traditionnelles mais intégration (ouverture sur l’histoire, sur les langues romanes, sur les langues africaines, sur la littérature française, sur la littérature comparée, prise en compte de la variation dialectale, de la description grammaticale, des mécanismes de créolisation, des données anthropologiques, de l’écriture comme graphie et de l’écriture comme acte de créativité, introduction aux problèmes de la diglossie littéraire et aux stratégies de la créolité conçue comme mouvement esthétique et singulièrement littéraire etc.).
-
Diplôme polyvalent permettant d’orienter l’étudiant vers les concours traditionnels du second degré y compris avec l’espoir de concours relatifs à la discipline créole.
-
Ne pas imaginer au créole un passé scolaire en lui prêtant le passé scolaire du français. Avoir de l’humilité, de la patience et ne pas vouloir fabriquer de toutes pièces au créole une identité pédagogique qu’il ne construira que dans et à travers sa propre institution comme langue de la pédagogie scolaire.
-
Travailler et constituer au fil du temps (car le créole est une langue naturelle et non pas un esperanto) une métalangue créole au service des pratiques pédagogiques. La langue, objet d’analyse, devrait devenir également instrument d’analyse.
30À partir de là, toutes les hypothèses programmatiques sont possibles et différents types d’exercices peuvent être conçus selon une échelle graduée envisageant l’ensemble du cursus. Car il faut avoir une vision globale et non pas ponctualiste, localiste du domaine de la didactique créole.
Conclusion
31Il semblait important de rénover la vision traditionnelle de la diglossie en tenant compte à la fois des données écosystémiques et des aspirations identitaires. C’est à ce prix que, scientifiquement informées, l’ensemble des communautés créolophones pourront remplacer le duel idéologique créole-français par un duo fonctionnel, fonctionnant donc sur une base de coopération, et définissant ce qu’il est convenu d’appeler un colinguisme. En ce sens, il n’est pas aberrant d’affirmer que, même si créole et français sont deux langues distinctes quoiqu’apparentées, la créolophonie peut être considérée comme appartenant à la grande galaxie francophone, tout en se situant au carrefour de cette galaxie et d’une autre, particulièrement importante dans la Caraïbe : la galaxie anglophone. L’existence de créoles à base française à Sainte-Lucie et à la Dominique en témoigne. Par contre, à ce jour, l’articulation avec la galaxie hispanophone ne présente pas les mêmes caractéristiques et est encore largement à découvrir. Aucune coopération économique ne pourra être efficace si, se déprenant des stéréotypes du passé, on ne cherche pas à construire sur des bases d’échange, de réciprocité mais aussi de rigueur scientifique, la Caraïbe des langues et des cultures.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l'outil d'annotation bibliographique d'OpenEdition.
Les utilisateurs des institutions qui sont abonnées à un des programmes freemium d'OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lequelles Bilbo a trouvé un DOI.
Bernabé Jean, « Réflexions pour une glottopolitique des aires concernées par le créole » dans les Exposés-débats du CRESTIG : La créolité, la guyanité, 1989.
Bernabé Jean, Chamoiseau Patrick, Confiant Raphaël, Éloge de la créolité, 1989.
Bickerton Derek, « The nature of a creole continuum » dans Language, vol. 49, fasc. 3, 1973, p. 640-669.
DOI : 10.2307/412355
Calvet Louis Jean, Linguistique et colonialisme : petit traité de glottophagie, Paris, Payot, 1974.
Ferguson Charles A., « Diglossia », dans Word, 1959, n° 15, p. 325-340.
DOI : 10.1080/00437956.1959.11659702
Gardin B., Marcellesi J.-B., Sociolinguistique, Approches, Théories, Pratiques, Paris, PUF, 1980.
Hall R.-A.-J., Pidgins and creoles languages, Ithaca, Cornell University Press, 1966.
Prudent Lambert-Félix, « Diglossie ou continuum ? Quelques concepts problématiques de la créolistique moderne appliqués à l’archipel Caraïbe », dans B. Gardin, J.-B. Marcellesi, 1980.
Notes
1 Ce mot-valise désigne le créolophone ayant vécu en France et mettant en œuvre, de ce fait, des pratiques linguistiques et culturelles en rupture d'avec les pratiques linguistiques et culturelles des régions créolophones.
Pour citer cet article
Référence papier
Jean Bernabé, « Un regard nouveau sur la diglossie français-créole. Esquisse d’une approche écosystémique des langues », La Bretagne Linguistique, 9 | 1993, 7-18.
Référence électronique
Jean Bernabé, « Un regard nouveau sur la diglossie français-créole. Esquisse d’une approche écosystémique des langues », La Bretagne Linguistique [En ligne], 9 | 1993, mis en ligne le 02 janvier 2022, consulté le 21 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/lbl/5722
Auteur
Jean Bernabé
Professeur à l’Université des Antilles et de la Guyane
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 204 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Commentaires récents
Quand l'IA se transforme en intelligence des ânes
Triste époque !
Frédéric C.
21/01/2026 - 14:30
Je partage tout ce qui est écrit dans l’article. Ce...truc est absolument ABJECT, DÉGUEULASSE ! Lire la suite
Quand l'IA se transforme en intelligence des ânes
LAMENTABLE...
Albè
21/01/2026 - 08:54
Mon grand-père aimait répéter que nombre de Martiniquais ont du "kaka-bef" dans la tête. Lire la suite
Littérature caribéenne et guyanaise d'expression française et créole : ouvrages critiques
NEG PA KA LI !
Albè
20/01/2026 - 19:45
Belle liste mais parfaitement inutile car comme aimait à dire mon grand-père : "Nèg pa ka li. Lire la suite
Campagne électorale à Foyal : on frôle l'indigence intelectuelle
Wè. Mais...
Frédéric C.
20/01/2026 - 10:09
...Ça marche pas avec les Mémés ni avec les Tontons et Tatis. Lire la suite
Sa bel ba zot sé Afritjen-an !
Albè man dakò:...
Frédéric C.
20/01/2026 - 10:00
...ni on ti pawòl ka di-w: "Protégez-moi de mes amis. Mes ennemis je m’en charge!". Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Quand l'IA se transforme en intelligence des ânes
- Édwa Glissant ek « bòbò-a » - Le « détour » : fondement de la nomination du corps de la prostituée
- Shaquille O'Neal et Recip Tayyip Erdogan
- Sudhir Hazareesingh : Non, les esclavés n’étaient pas passifs
- Campagne électorale à Foyal : on frôle l'indigence intelectuelle
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus