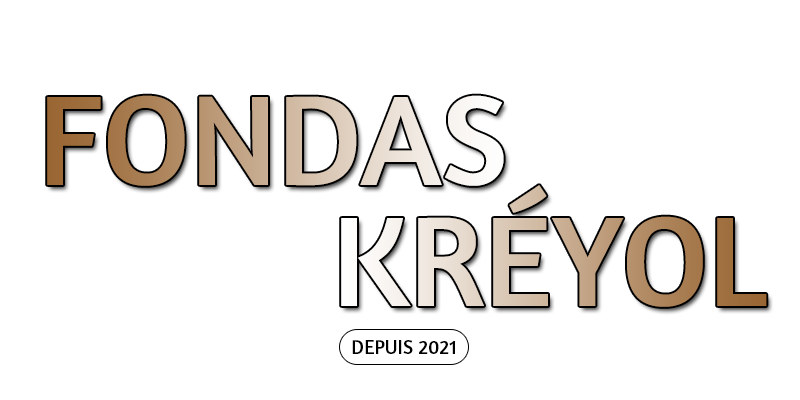«Au Japon, ce n’est pas seulement la naturalisation qui dérange, mais l’idée même d’un étranger vivant dans l’archipel»
de Christian Kessler

FIGAROVOX/TRIBUNE - Le Parlement japonais a récemment débattu d’un possible durcissement des conditions de naturalisation. Derrière ces discussions affleure l’imaginaire d’une nation fondée sur une histoire figée, bien éloigné de la conception française en la matière, analyse l’historien Christian Kessler.
Des discussions parlementaires ont eu lieu le mois dernier au Japon au sujet de la naturalisation, qui donne le droit de vote aux élections. La raison invoquée : elle semble plus facile à obtenir que le permis de résidence permanent. Pour obtenir la nationalité japonaise, il faut avoir résidé cinq années consécutives dans le pays, soit en fait la moitié de la durée requise pour la résidence permanente.
S’appuyant sur cette anomalie, Hirofumi Yanagase, député de la chambre haute, veut changer les règles de la naturalisation. Pour lui et nombre de ses pairs, résider cinq ans au Japon ne peut suffire à comprendre le pays, donc à être naturalisé, et donc à voter. Il appelle avec beaucoup d’autres à rendre plus difficile la naturalisation, elle qui l’est pourtant déjà tellement dans la réalité. Derrière ces raisons invoquées, plus que douteuses, c’est en fait l’idée même de la citoyenneté japonaise qu’il faut questionner.
Au vrai, quelles que soient les raisons évoquées plus haut, et qui ne sont que des discussions techniques, le Japon n’accorde la nationalité qu’avec parcimonie. Pour l’obtenir, un long chemin de croix attend le postulant, qui devra de plus abandonner sa nationalité d’origine. Pas de double nationalité possible. Il faut comprendre – comme l’explique l’écrivain Akira Mizubayashi dans son magnifique Petit éloge de l’errance – que la communauté nationale n’est pas liée à une association libre d’individus qui passe un contrat pour vivre ensemble, issue donc d’une décision commune prise collectivement, comme c’est le cas pour la nationalité française, par exemple. Non, la nation japonaise ne provient pas d’un cheminement historique, c’est tout le contraire.
En effet, elle ne passe pas par une association librement voulue, car elle précède les individus et l’histoire en quelque sorte. Elle est immuablement figée dans ses origines mythiques, que les vicissitudes du temps ne sauraient altérer. La communauté nationale au Japon se fonde sur l’idée d’ethnicité, sur une pureté imaginaire basée sur le sang, qui exclut d’emblée l’Autre.
À partir de là, ce n’est pas seulement la naturalisation qui pose problème, c’est l’idée même d’un étranger vivant dans l’archipel qui dérange. Si l’on peut certes y vivre en bonne harmonie avec les « vrais » nationaux, on sera toujours considéré comme venant de l’extérieur. Tout étranger le sait : quels que soient ses efforts d’intégration – par la connaissance de la langue, de l’histoire et de la culture japonaises –, et même s’il a obtenu la nationalité, il ne sera jamais considéré comme faisant partie de la collectivité nationale.
Cette idée de dedans et de dehors est évidemment mise à mal, par exemple, par les Coréens vivant au Japon, qui brouillent les repères. Leur massacre en 1923, lors du grand tremblement de terre du Kanto, s’explique justement par le fait qu’ils ressemblent aux Japonais, qu’ils vivent absolument comme eux, et qu’il est donc difficile de les distinguer. Situés au premier rang dans l’échelle ethnique impériale, ils étaient placés au premier rang sur la voie de l’intégration, de l’assimilation coloniale. Étant considéré comme scandaleux de pouvoir se faire passer pour de vrais Japonais, ils sont alors perçus, dans les décombres et le feu du séisme, comme la base avancée d’un complot – ils empoisonneraient notamment les puits – visant à mettre à mal la nation japonaise, et doivent de ce fait être mis hors d’état de nuire.
Des manifestations plus récentes – en 2013, 2016, 2019 – contre les Coréens, souvent violentes, rappellent à quel point le brouillage de la frontière d’ethnicité, associé aussi à des tensions diplomatiques, peut être dangereux. « Il faut tuer les Coréens, bons ou mauvais ! », pouvait-on lire sur les banderoles déployées par les manifestants. Ou encore : « Tuez-les tous ! »
Dans ce sens, la naturalisation effraie, car elle brouille la frontière du dedans et du dehors. Elle met à mal la délimitation entre le soi et l’autre. C’est aussi que, si le nationalisme européen né au XIXe siècle n’est que l’histoire d’un instant – réactivé farouchement en ce moment, certes –, le Japon, lui, a un nationalisme beaucoup plus ancien. Depuis toujours, pourrait-on dire. Depuis ses fondations et son institution impériale mythique, inchangées depuis plus de deux mille ans, au point qu’on a pu la comparer à ce que serait la Rome antique si elle existait encore de nos jours, en continuité dynastique depuis Rémus et Romulus.
Un nationalisme dans lequel le Japon se sent tout à fait à l’aise, facile à activer et à réactiver le moment venu, comme dans les années 1930, par la mise en avant continue d’une langue dont on aime à dire qu’elle n’a absolument pas d’origine étrangère, d’une civilisation absolument originale, d’un territoire dont les contours semblent clairement définis par la mer. Bref, d’un nationalisme unique qui se veut absolument distinct du reste du monde.
Si prendre la nationalité japonaise s’avère très difficile, il est de toute façon impossible d’être considéré comme appartenant à la communauté nationale, au grand dam des étrangers qui se laissent souvent prendre par la politesse ambiante légendaire. On accueille certes les étrangers pour les services qu’ils peuvent rendre – c’est le cas depuis l’ouverture de Meiji au milieu du XIXe siècle –, mais on aime plus encore qu’ils repartent ensuite… et pourquoi pas, le plus vite possible. Dont acte !
Christian Kessler est historien, professeur détaché à l’Athénée français de Tokyo et enseignant à l’université Musashi. Dernier ouvrage paru : Les kamikazés, leur histoire, leurs ultimes écrits (Perrin, août 2024).
«Au Japon, ce n’est pas seulement la naturalisation qui dérange, mais l’idée même d’un étranger vivant dans l’archipel»© RICHARD A. BROOKS / AFP
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 161 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
30/01/2026 - 10:43
Valérie Parlan ("Ouest-France")
15/12/2025 - 19:43
Commentaires récents
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Le rejet des Maghrébins existe depuis...
Frédéric C.
30/01/2026 - 22:17
...longtemps en France. On le retrouve même chez de grands écrivains comme Léo Malet... Lire la suite
Qui prétend que la langue créole est pauvre du point de vue du vocabulaire ?
Ne pourrait-on pas ajouter...
Frédéric C.
30/01/2026 - 21:53
...au moins par extension : "Rat"?
Lire la suite« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Tim-hitler : Vous voila venger
@Lidé
30/01/2026 - 17:36
Il y à des mois en arrière tim-hitler justifiait l'arabophobie des ces maitres blancs,
Lire la suiteImpudences békées...
CONARD, VA !
Albè
29/01/2026 - 17:22
Le dénommé "ABCX" revient avec un nouveau pseudo, TIM, ou peut-être d'un ancien vu qu'il en chang Lire la suite
Impudences békées...
Le transport fonctionne très mal en Mqe ,vous ne savez pas ça?
tim
29/01/2026 - 14:40
1) Qu'on soit Nègre ,Béké ou Indien ont a quand même le droit de le dire ,non ?Alors les Békés n' Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Didier Laguerre (PPM) lance sa campagne électorale
- Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
- Sweet potato king: Ramdeo Boondoo gets Chaconia gold for life in agriculture
- Qui prétend que la langue créole est pauvre du point de vue du vocabulaire ?
- De l’usage du créole dans l’apprentissage scolaire en Haïti : qu’en savons-nous vraiment ?
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus