La France est-elle un pays raciste ?

La question du débat « La France est-elle raciste ? » peut paraître provocatrice. D’aucuns y répondront non, préférant ne pas généraliser et plutôt désigner une frange de la population. Mais il y a lieu d’interroger et d’approfondir les notions de « racisme systémique » ou structurel et de « racisme d’État » et de mesurer les effets de la banalisation d’une parole raciste qui se libère jusqu’à conduire au crime.
À l’Agora de la Fête de l’Humanité, vendredi 12 septembre, les intervenants sont allés bien au-delà des constats et des analyses, ils ont échangé sur la façon de mener le plus efficacement le combat antiraciste.
Peut-on affirmer qu’il existe, aujourd’hui en France, un « racisme d’État » ?
Arié Alimi Sur le titre même de ce débat, j’aurais tendance à dire que tous les pays colonisateurs ont développé un dispositif à caractère raciste. À savoir une doctrine et une pratique qui considèrent qu’il y a des races et qu’il y a une hiérarchie entre ces races. Cette vision a même été au cœur d’une théorie humaniste au XIXe siècle selon laquelle on pouvait apporter la bonne parole à des peuples sauvages. Cela a nourri l’impérialisme et la colonisation.
L’histoire est constituée de structures. Les institutions françaises et nous-mêmes, individuellement, sommes le fruit de cette histoire. Il y a plusieurs définitions d’un « État raciste ». Selon la définition traditionnelle, celle qui relève de la recherche, seuls ceux qui ont édicté des normes avec une discrimination et une différence en raison de l’appartenance, de l’origine, de la couleur de peau, de la confession, sont des États à caractère raciste. C’est le cas de l’Allemagne hitlérienne à l’égard des juifs et de l’apartheid en Afrique du Sud.
Dans la France de 2025, il n’y a pas de normes expressément racistes. En revanche, il existe des dispositifs, comme les circulaires qui ont motivé la loi dite séparatisme, visant des personnes en raison de leur confession musulmane : des associations de mosquées, des imams…
Autre exemple que nous venons de plaider au Conseil d’État : le schéma national des violences urbaines (SNVU) du 31 juillet. Il crée une distinction entre les manifestants, en créant une catégorie relevant des « violences urbaines » donnant l’exemple des révoltes populaires de 2005. Il s’agit pour la plupart de personnes noires ou arabes, issues d’une immigration postcoloniale. L’État tente d’appliquer un dispositif particulier pour ces personnes.
Que pensez-vous de ce racisme qui ne dit pas son nom dans certains dispositifs ? La notion de « racisme systémique » vous laisse sceptique, Florian Gulli, pour quelles raisons ?
Florian Gulli J’ai trouvé cette notion de « racisme systémique » dans l’ouvrage Black Power, pour une politique de libération, publié aux États-Unis en 1967, juste après la promulgation des lois mettant un terme à la ségrégation. Les militants afro-américains proposent ce concept de racisme structurel après la fin de la discrimination légale, en opposition à celui de racisme individuel. Ainsi, par exemple, lorsqu’il y a un attentat dans une église afro-américaine à Birmingham en Alabama, la totalité de la classe politique américaine le condamne. Cet acte de racisme individuel fait l’objet d’un rejet consensuel.
En revanche, le fait que, dans la maternité noire de Birmingham, la mortalité infantile soit plus élevée que dans la maternité blanche passe sous les radars. Dans cet ouvrage, il y a une sorte d’ambiguïté. Tantôt, le concept sert à nommer des institutions déterminées : commissariat, service de voirie, bailleur de fonds… Ils ont des pratiques racistes, malgré la fin du racisme légal.
Ce sens-là de racisme institutionnel est très utile à la lutte antiraciste, car on ne peut pas réduire le racisme à l’acte individuel. Mais il y a d’autres usages du mot où le racisme systémique désigne la structure sociale, la nation dans sa totalité. Ce qui est difficile à établir et ne me semble pas utile. Le problème est alors son effet essentialisant.
Dire « la France est raciste », c’est un peu comme dire « la France est le pays des droits de l’homme ». Ces formules sont beaucoup trop rapides, elles occultent le fait qu’une nation est structurée par des contradictions. Il y a dans l’histoire de France des traditions égalitaires et d’autres inégalitaires qui se combattent. Aujourd’hui en France comme aux États-Unis, ce ne sont pas les visions égalitaires qui sont en position de force, mais penser ce que font des individus à d’autres individus par le seul prisme du racisme est beaucoup trop étroit.
Votre ouvrage « Discriminations » fait la synthèse de nombreuses études pour en mesurer l’ampleur, comprendre leur origine et comment les combattre. Pour quelles raisons, Mirna Safi, tenez-vous à faire la distinction entre discriminations et racisme ?
Mirna Safi C’est important de définir les concepts car cela a des effets directs sur la manière dont on les mesure, sans les mettre en concurrence. En sciences sociales, on considère qu’il y a discrimination quand il y a un traitement inégal envers des individus en raison de leur appartenance à un ou des groupes.
Exemple : prendre en compte l’origine ou le genre d’un candidat pour un poste de travail. Telle qu’elle est ainsi définie, la discrimination est différente des écarts. Les écarts que l’on observe dans l’emploi ou le logement ne peuvent pas tous être attribués à un traitement inégal. La discrimination est différente des comportements, des opinions, de la haine raciale.
Dans la société française actuelle, posons-nous la question de savoir dans quelle mesure une extrême droite forte, une droite et une Macronie lui emboîtant le pas et des discours médiatiques que l’on connaît font-elles augmenter les discriminations ?
De nombreux travaux montrent, par exemple, que les médias ont tendance à couvrir un fait divers lorsqu’un étranger est impliqué dans l’acte ou supposé impliqué dans l’acte. Ce biais dans les couvertures médiatiques va influencer les gens. Une étude récente en Suisse a permis de quantifier comment l’amplification de l’information traitée avec ce biais et reprise par de nombreux autres médias pouvait influencer l’opinion.
Dans les enquêtes, les gens disent de moins en moins qu’ils sont racistes. En même temps, on le voit très fortement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France, des médias ont pour programme idéologique de libérer la parole raciste. Des études commencent à le documenter.
Les études de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) font état, ces trente dernières années, d’une progression du niveau de tolérance de la population française. Parallèlement, les violences racistes sont en hausse ainsi que les scores de l’extrême droite aux élections. Que pensez-vous de cette sorte de paradoxe ?
Florian Gulli Durant la campagne législative 2024, nous avons vu plusieurs exemples de libération et de décomplexion de la parole raciste. Des chaînes d’info continue ne s’en privent pas, ainsi qu’au sein du gouvernement, lorsque Bruno Retailleau lance « Vive le sport, à bas le voile ».
Ensuite, en effet, il y a une sorte de paradoxe. Outre l’étude de la CNCDH, les travaux de Vincent Tiberj montrent que la droitisation, qui s’opère en haut, ne correspond pas à la droitisation du bas. La tolérance progresse à l’égard des minorités ethniques, l’homophobie a reculé de manière spectaculaire depuis les années 1980. Dans le même temps, le FN puis le RN progressent. Il y a sans doute toute une partie de cet électorat qui vote RN et qui se dit tolérante lorsqu’elle répond à des enquêtes.
Cela nous conduit, en tant que militants de gauche, à nous poser la question de continuer à travailler en direction de ceux qui pourraient être séduits par cet électorat. Le facteur raciste n’explique pas à lui seul le vote RN. Il y a désormais un vote Marine Le Pen très fort aux Antilles. Des camarades du Parti communiste de la Martinique y pointent une dimension sécuritaire.
De la même manière, une part des secteurs traditionnellement de gauche comme les métiers du soin ou d’enseignant commencent à voter de plus en plus RN. Et sans doute ils se définissent comme des gens tolérants. Nous devons comprendre davantage ces logiques et être capables de proposer un discours adéquat.
Plusieurs chiffres font état d’une explosion des actes antisémites. Arié Alimi, il y a un an, vous avez publié le livre « Juif, Français, de gauche… dans le désordre », dans lequel vous pointez des difficultés qu’il peut y avoir, à gauche, d’articuler à la fois les luttes contre le racisme, la lutte pour les droits du peuple palestinien et la lutte contre l’antisémitisme. Depuis, voyez-vous une évolution ?
Arié Alimi On en parle davantage, mais les lignes de fracture existent toujours malheureusement à un moment où il est plus qu’urgent que toutes les composantes de la gauche et des progressistes, qui luttent contre tous les racismes, doivent être unies. Il vaut mieux être dans l’action car on se retrouve quand on lutte ensemble, on apprend à s’aimer.
Il y a eu le 7 octobre 2023 et les actes commis par le Hamas sur des civils israéliens. Et puis il y a le génocide en cours à Gaza. Il y a une instrumentalisation évidente de l’antisémitisme. On a un peu de mal à distinguer l’identité juive de la question sioniste. Amalgames et confusions crispent à gauche. J’ai essayé avec ce livre de resituer ces mots et leur sens dans l’histoire de façon à permettre d’instaurer un dialogue plutôt que de créer du clivage.
Abordons maintenant le sujet du combat antiraciste. Florian Gulli vous avez publié un ouvrage, « l’Antiracisme trahi », dans lequel vous défendez la notion d’antiracisme socialiste. De quoi s’agit-il ?
Florian Gulli Il y a plusieurs courants de l’antiracisme. J’ai travaillé dans une approche matérialiste à savoir que, pour comprendre le racisme, il ne faut pas partir de ce que les gens ont dans la tête mais des situations matérielles concrètes qui ont produit ce que les gens ont dans la tête. On ne peut penser le racisme anti-Noirs aux États-Unis indépendamment de l’exploitation du travail contraint des esclaves.
C’est la base matérielle qui va produire peu à peu un discours anti-Noirs. De même que la colonisation, l’expropriation de populations, les ségrégations urbaines. Antiracisme « socialiste », c’est une stratégie politique. C’est l’idée que la lutte contre le racisme est absolument nécessaire dans une perspective populaire car elle fracture la classe. Tant que le racisme est là, aucun progrès social n’est possible. On le voit depuis quarante ans, les classes populaires sont désunies, elles répartissent leurs votes sur différentes formations.
Si on veut mener une lutte majoritaire, il est impératif de dépasser le racisme. Oui, il y a différentes fractions des classes populaires, dans les quartiers, hors des quartiers, oui, il y a des spécificités dans chacune de ces fractions qu’il ne faut pas mettre sous le tapis. Mais il y a aussi tout un ensemble d’intérêts communs. Il me semble qu’il y a peu de discours antiracistes qui insistent sur les points communs des différentes catégories populaires.
En matière de lutte contre les discriminations, y a-t-il dans vos recherches, Mirna Safi, des pistes qui vous paraissent plus efficaces que d’autres ?
Mirna Safi Il y a urgence en France d’agir dans ce domaine. Il existe trois pistes intéressantes : instaurer plus de transparence sur les données (encadrées par la Cnil) dans les entreprises et les administrations comme c’est le cas pour le genre et le handicap ; avoir une agence indépendante pour le « testing » (évaluation), le suivi et les outils d’intervention de politiques publiques ; enfin, changer le narratif dominant dans le débat public, déstigmatiser les minorités, arrêter d’attiser les tensions.
Comment et pourquoi articuler luttes sociales et lutte antiraciste ?
Arié Alimi La lutte est intersectionnelle car le racisme est multifactoriel. Il y a une difficulté dans les grilles de lecture à faire une synthèse entre lutte des classes et racisme et antiracisme. L’intersectionnalité est une voie possible, pas la seule et unique. La lutte contre tous les racismes, contre l’antisémitisme, l’islamophobie doit être indivisible, de même que lutte des classes et antiracisme doivent être indivisibles.
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 168 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Valérie Parlan ("Ouest-France")
15/12/2025 - 19:43
09/12/2025 - 10:07
Staff writer ("Saintluciadailypost.com")
08/12/2025 - 08:07
Commentaires récents
Si la langue créole en est arrivée là aujourd'hui...
Oui, Albè...
Frédéric C.
09/01/2026 - 11:42
...j’ai vu l’ouvrage. Lire la suite
L'administration Trump conclut un accord avec la Dominique pour envoyer des demandeurs d'asile américains
Qui parle ?
tim
09/01/2026 - 11:28
"Chivé-yo two grennen ek nen-yo two laj: "Quel auteur se cache derrière cette déclaration négrop Lire la suite
L'administration Trump conclut un accord avec la Dominique pour envoyer des demandeurs d'asile américains
OH, NON !
Albè
08/01/2026 - 19:49
Chivé-o two grennen ek nen-yo two laj.
Lire la suiteL'administration Trump conclut un accord avec la Dominique pour envoyer des demandeurs d'asile américains
25000
tim
08/01/2026 - 19:21
10000 latinos et 15000 Haïtiens.
Lire la suiteL'administration Trump conclut un accord avec la Dominique pour envoyer des demandeurs d'asile américains
TOUT A FAIT D'ACCORD !
Albè
08/01/2026 - 18:58
Vu que les Martiniquais ne font plus d'enfants, ce serait bénéfique de recevoir au moins 10.000 L Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- La vérité sur le sort de l'ex-hôtel Marouba au Carbet
- Konprann sa leksikografi kreyòl la ye, kote l sòti, kote l prale, ki misyon li dwe akonpli
- L'administration Trump conclut un accord avec la Dominique pour envoyer des demandeurs d'asile américains
- EU delivers Ultimatum to Caribbean CBI nations
- De l’usage du créole dans l’apprentissage scolaire en Haïti : qu’en savons-nous vraiment ?
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus
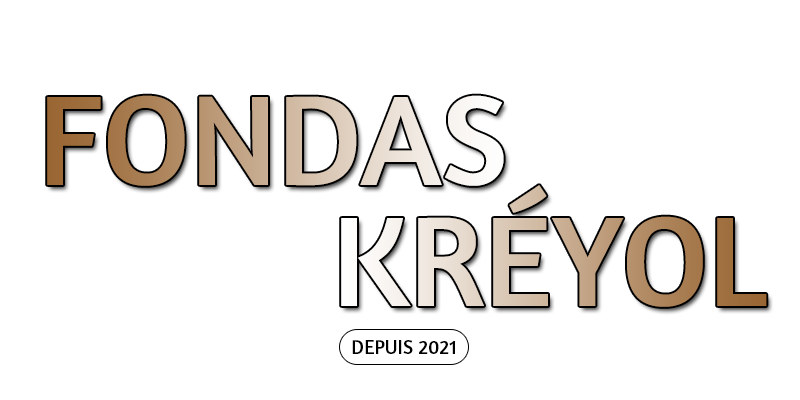





Commentaires
La France raciste ? Bof...pas plus que la Tunisie !!!
poi
04/10/2025 - 10:00
Il aurait été très interessant de se livrer à une "étude instersectionnelle" sur ce même sujet en Tunisie ou au Maghreb de manière générale !!!S'il y a un pays où le "racisme systémique " existe c'est bien la Tunisie ,pour ne prendre qu'un exemple maghrébin parmi d'autres, nous avons l'embarras du choix !!Systémique car existant depuis longtemps (voir Fanon ) ,partagé par une partire importante de la population pas tous certes ,soutenu par les médias et excité par le chef de l'Etat lui-même .Puisque c'est un simple discours de S.Kaïci ,souvenez vous qui avait entrainé les massacres anti-nègres l'année dernière. Si ce n'est pas "systémique", je ne sais pas ce que ce mot veut dire !!
OBSESSION
Albè
04/10/2025 - 10:39
Voilà à nouveau le retour de notre prostatique arabophobe qui saisit la moindre occasion pour essayer de détourner le sens des articles de FONDAS ! C'est pathétique cette obsession au point qu'on se demande pourquoi il ne crée pas son propre site-web pour mieux y déverser ses obsessions. au lieu de polluer FONDAS.