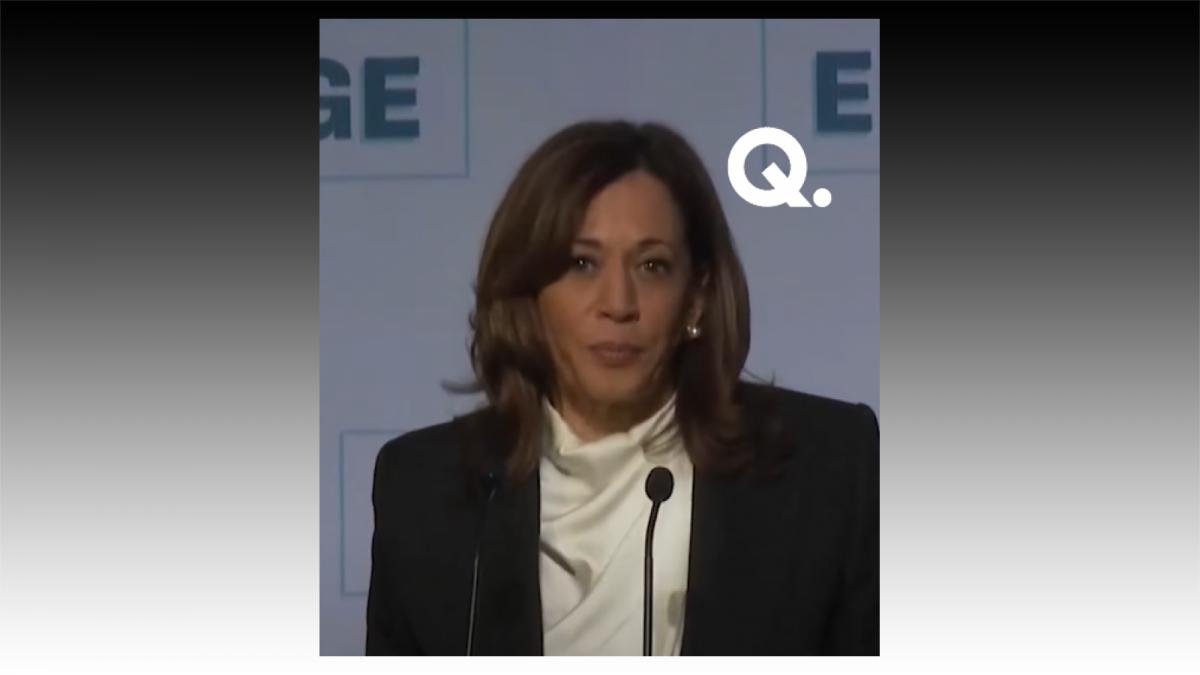À propos d’un certain Daoud, par Frantz Fanon

Hier, 13 août 2025, nous avons reçu dans nos services un certain Kamel Daoud. En apparence, aucun signe de maladie mentale : le regard clair, la parole fluide, la tenue impeccable. Il s’exprime avec aisance, manie le français avec l’assurance d’un agrégé, cite ici ou là des auteurs qu’il a, semble-t-il, lus. Rien qui ne laisse supposer la moindre agitation pathologique.
Mais, à l’écoute attentive, le verbe trahit l’esprit. Derrière les mots policés, se dessine la mécanique bien huilée du colonisé exemplaire. Ce sujet ne hurle pas son aliénation : il l’énonce, la justifie, la théorise. Il est venu nous parler des “Kabyles”, non comme d’un peuple vivant et complexe, mais comme d’une catégorie figée, utile à la démonstration qu’il prépare pour un public précis, celui de la France qui aime ses indigènes bien rangés. Il les décrit “anti-islamistes”, “réformateurs”, “autre Algérie” : un bouquet d’épithètes soigneusement choisi pour flatter la sensibilité de ses hôtes éditoriaux. Ainsi, les Kabyles deviennent non pas eux-mêmes, mais le miroir inversé du reste de l’Algérie, l’outil parfait de la division. Le procédé est ancien : le colon appelait cela “tribu amie”.
Ce n’est pas la Kabylie que Daoud défend. C’est l’idée qu’une partie du colonisé peut et doit être tenue pour “fréquentable” tant qu’elle épouse les contours rêvés par le colon. Ce type de discours ne libère pas : il classe, il hiérarchise, il reconduit la tutelle en l’habillant d’éloges sélectifs. Monsieur Daoud écrit avec la ferveur de l’ethnographe du dimanche ; mais son public, ce n’est pas la Kabylie, mais la France qui rêve encore de trouver, dans ses anciennes colonies, quelques tribus dignes de son approbation. Il leur tend le miroir colonial ; il sourit en espérant qu’ils y voient autre chose qu’un visage apprivoisé.
Diagnostic : aliénation avancée, identification au regard de l’Autre, fixation à l’imaginaire colonial, transfert affectif vers la culture dominante, syndrome de reconnaissance conditionnelle. Dans « Peaux noires, masques blancs », j’écrivais que le colonisé qui adopte les codes du maître pour se faire reconnaître finit par ne plus savoir où commence son visage et où finit son masque. Daoud illustre ce stade avancé : il choisit les angles, les métaphores et les indignations qui corroborent les préjugés de la métropole cultivée, minimisant ou passant sous silence ce qui démentirait ce récit. Ici, à Blida-Joinville, il nous arrive de rencontrer des cas d’une pureté clinique saisissante. Monsieur Daoud en est un. Non pas l’aliéné hurlant ou délirant ; il est beaucoup plus inquiétant. Il est le produit achevé de ce que j’appelais jadis l’« intellectuel colonisé » : celui qui a troqué son imaginaire contre un vocabulaire d’importation, celui qui contemple son peuple depuis le balcon d’une villa française, tout en prétendant le décrire.
Ici, à Blida-Joinville, nous soignons les corps et les esprits meurtris par la colonisation. Mais il arrive, parfois, que certains préfèrent conserver leurs chaînes, les polir, les parfumer, et les brandir comme preuves de leur liberté. Monsieur Daoud appartient à cette catégorie rare, fascinante et tragique.
———————————————————————————
Hier nuit, dans la chaleur étouffante de mon lit, l’insomnie m’a saisie. Les heures passaient, lentes, et mon esprit, au lieu de sombrer dans le sommeil, s’est mis à divaguer. Alors, j’ai imaginé une scène : Frantz Fanon, dans son bureau de l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, recevant un patient pas comme les autres. Je voyais la pièce, les dossiers empilés, la blouse blanche de Fanon, son regard perplexe face à ce cas d’école …
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 666 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
25/01/2026 - 19:39
19/01/2026 - 07:53
19/01/2026 - 07:44
Trtafrika
12/01/2026 - 18:25
11/01/2026 - 18:21
Commentaires récents
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Albè, en fait nous sommes globalement...
Frédéric C.
31/01/2026 - 20:22
...d’accord. Vous dites que ces Arabes d’antan se sont "mélangés" aux peuples préexistant. Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
GROSSE DIFFERENCE
Albè
31/01/2026 - 18:30
Les Espagnols et les Portugais ont quitté l'Amérique du Sud donc les habitants de cette région ne Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Albè, déjà...
Frédéric C.
31/01/2026 - 11:48
...Le mot "race" est-il pertinent? NON. Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
DANS LE CORAN...
Albè
31/01/2026 - 09:07
...Mahomet dit : "L'arabe est une habitude de la langue et qui donc parle arabe est un Arabe". Lire la suite
« Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
Albè, il est possible qu’@Lidé rebondisse...
Frédéric C.
31/01/2026 - 08:05
...seulement sur le terme que j’ai utilisé pour parler du Maghreb. Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- « Qu’il crève, vive Le Pen ! » : 18 ans de réclusion pour une tentative de meurtre raciste
- Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
- Thaïlande : une vague à l'âme
- L’HOTEL MAROUBA REPRIS PAR NEXALIA ET LE GROUPE BEST WESTERN
- Un artisan pierrotin juge l'évolution de sa ville
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus