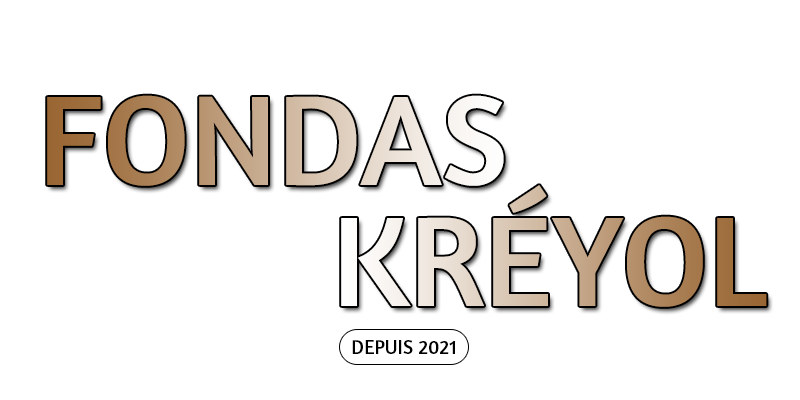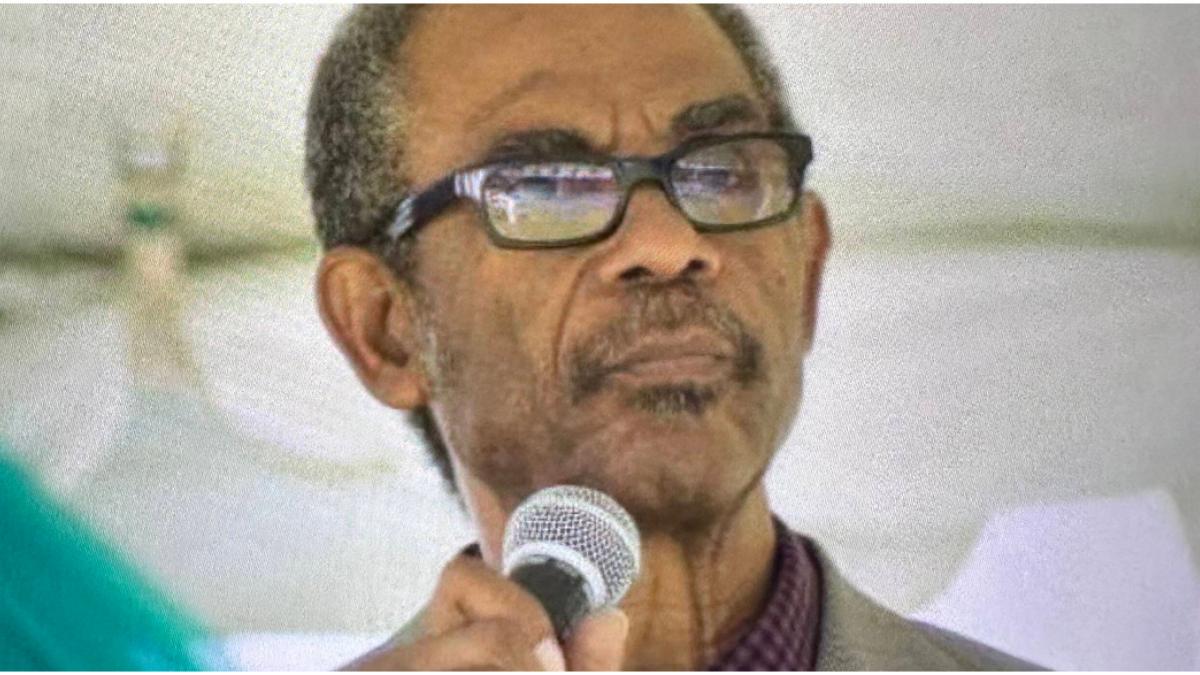Machann manje: composante essentielle de l’écosystème urbain haïtien

"La ville féministe est une ville où les barrières – sociales et physiques – sont abattues, une ville centrée sur le soin et le soutien d’autrui, découlant du pouvoir inhérent des villes à rassembler. " (Kern, 2020, p. 54)
Dans les villes haïtiennes, la restauration de rue constitue une composante essentielle du paysage social et économique. Sur le plan lexical, il existe un ensemble d’expressions pour parler de la restauration de rue : akwoupim chaje, manje kwit, aleken, anba dra, chen janbe, ban a pye. Dans cette dynamique, les femmes (machann manje) occupent une place de premier rang, tant comme entrepreneures, marchandes, cuisinières, serveuses, vendeuses de boissons que comme aides-cuisinières. La restauration de rue est l’un des espaces où les femmes sont les plus visibles en tant qu’actrices façonnant les dynamiques de la vie quotidienne dans les rues haïtiennes. Ces femmes cuisinent et vendent de la nourriture dans la rue. Leur travail montre qu'il existe un lien entre la restauration de rue et leur présence dans cet espace, où elles exécutent une activité quotidienne de subsistance.
Par travail de subsistance, j’entends, à la suite des auteurs et autrices du Collectif Rosa Bonheur travaillant sur la ville dans une perspective « par le bas »,
« des activités qui sont orientées vers la prise en charge des besoins des autres et qui se déploient avant tout dans des réseaux de proximité. Le propre de ce travail est d’être à la fois dans et hors du marché et de permettre de satisfaire les besoins de la vie quotidienne » (Collectif Rosa Bonheur & Delfini, 2019).
Ainsi, à partir de cette activité, les femmes tissent un maillage de relations informelles qui concourt au maintien de la vie urbaine et, plus largement, de la société nationale, dans un contexte où se nourrir n’est pas toujours évident pour une partie non négligeable des populations urbaines.
En termes de profil sociodémographique, les restauratrices de rue sont majoritairement des femmes âgées de 25 à 60 ans. Elles sont généralement issues de l’arrière-pays et migrent vers les centres urbains en quête de ressources. Souvent sans emploi formel, sans formation professionnelle et avec un bagage académique limité, ces femmes créent leur propre source de revenus à partir d’une compétence traditionnellement assignée aux femmes : la cuisine.
En termes de rapports de sexe, l’originalité de cette figure se remarque dans le fait qu’elles mobilisent une compétence assignée aux femmes pour légitimer leur présence dans la rue en tant que travailleuses. Elles fabriquent ainsi leur légitimité dans la rue en investissant une niche liée à un besoin essentiel de la vie quotidienne : se nourrir. Ces femmes disposent d’un ensemble de compétences sociales acquises dans l’espace domestique qui leur permettent de tisser des liens entre divers réseaux d’acteurs et d’établir un maillage social autour de cette activité qui présente des dimensions sociales, économiques, culturelles et politiques.
Sur le plan social, ces femmes disposent de la capacité de choisir leur place, c’est-à-dire celle de pouvoir établir, implanter et conserver leur emplacement commercial. Je suppose qu’elles ne choisissent pas un carrefour ou un coin de rue par hasard. Elles disposent d’un ensemble de compétences en termes de savoir-faire relationnel pour se faire accepter dans un quartier et d’un sens de la ville leur permettant de gérer les attentes des consommateurs, tout en essayant également d’interagir avec les acteurs qui gèrent la ville, dont la mairie, les résident·e·s des quartiers et les agents de proximité de la mairie chargés de la voie publique.
Cela implique de savoir négocier des accords tacites avec des acteurs formels et non formels. Il convient de remarquer également que la restauratrice est un maillon entre le formel et l’informel sur le plan social, puisqu’elle se positionne fréquemment à proximité d’institutions publiques (hôpitaux, universités, banques), ce qui renforce sa visibilité et son rôle dans les flux urbains. Je suppose qu’elle possède des compétences pour dégager une contribution symbolique pour la « protection » ou l’accès à un emplacement, sans rompre l’équilibre de pouvoir. Faire ce premier pas implique le déploiement d’un capital culturel et symbolique, où elle doit interagir avec tous les acteurs intervenant sur un territoire, tout en trouvant l’équilibre entre ce qui va garantir le succès de son commerce, la conservation de son espace de travail et sa capacité à se fondre dans le décor social. Autrement dit, sur le plan social, la restauratrice de rue doit disposer d’un savoir-faire relationnel pour trouver une entente avec l’ensemble des acteurs présents sur le territoire choisi.
Il n’est pas anodin que dans certains quartiers cette figure soit absente, notamment dans les quartiers des classes moyennes. La nécessité d’acheter de la nourriture de rue au jour le jour n’est pas un besoin immédiat et quotidien pour ce groupe. Ainsi, s’instituer marchande de nourriture dans la rue, c’est avant tout établir un réseau de relations : relations de confiance avec la clientèle, relations tacites avec les autorités formelles et informelles, relations de proximité pour l’approvisionnement, relations avec le voisinage, relations avec les familles dans les quartiers, par exemple. La maîtrise de ces différentes dimensions est la clé pour assurer non seulement sa reproduction sociale au quotidien, mais aussi l’ancrage social et la reconnaissance symbolique de son activité.
Sur le plan économique, la restauratrice de rue doit disposer d’un sens économique pour maîtriser les circuits d’approvisionnement des produits et éviter des pertes et dépenses inutiles. Cela implique donc d’avoir des liens avec des producteurs et productrices clés, notamment de l’arrière-pays, afin d’avoir accès à des produits frais à un coût raisonnable, dans un espace très concurrentiel. Ce dernier aspect est important dans la mesure où la pérennisation de sa source de revenu dépend de sa réputation (entregent, propreté[1], flexibilité et compétences culinaires).
Les échanges qui structurent son commerce l’inscrivent dans un maillage économique plus large entre commerçantes : madan sara, vendeuses non ambulantes, revendeuses stables dans les marchés, manutentionnaires, etc.
Ensemble, ces personnes échangent informations, marchandises et services, renforçant un capital social fondamental pour la survie de chaque élément de l’écosystème urbain. La restauratrice de rue joue ainsi un rôle d’agente de relais entre différents espaces économiques et sociaux. Il en résulte aussi un réseau de liens entre femmes revendeuses, incluant les madan sara. Elle est un élément essentiel pour établir des points de contact avec des femmes issues de divers espaces. Pour répondre aux besoins d’accès aux numéraires au quotidien (achat de produits, renouvellement du matériel), elle mobilise les dispositifs de finance communautaire : caisses populaires, prêteurs informels (usurier·e·s), sòl ( tontines), sabotay.
Cette ingéniosité financière lui permet d’obtenir rapidement des liquidités tout en diversifiant ses sources de crédit, dans un contexte où l’accès aux banques demeure limité. Cette circulation permanente d’informations, d’échanges de biens et de services inscrit la restauratrice de rue au cœur de l’économie informelle et, dans une moindre mesure, de l’économie urbaine haïtienne.
En d’autres termes, elle est un point de contact entre tous les acteurs et actrices présents dans l’écosystème urbain, voire national. Elle est autant en interaction avec des fournisseurs (producteurs ruraux, grossistes), des transporteurs (chauffeurs de bus et de motos), des producteurs de charbon de bois, des autorités municipales et des usagers (clients, manutentionnaires).
Elle garantit la circulation de l’argent en embauchant, par exemple, d’autres femmes pour obtenir de l’aide au fur et à mesure que son commerce s’agrandit. Elle devient ainsi une employeuse dont l’activité génère des opportunités d’autonomie économique pour d’autres acteurs et actrices précaires de la ville.
Sur le plan économique, la restauratrice de rue se situe sur un double axe : l’axe horizontal, qui la met en relation avec les autres acteurs intervenant dans l’économie de maintien de la vie dans la ville, et l’axe vertical, où elle doit dialoguer avec les agents municipaux.
Sur le plan culturel, la restauratrice de rue utilise dans le système urbain des compétences construites dans le monde rural et le prolétariat urbain. Elle facilite le contact entre différents espaces de production de savoirs et de compétences dans le monde urbain. En outre, sur le plan gustatif, elle propose un dialogue entre la manière de préparer les mets dans son espace d’origine et celles qui sont validées dans le monde urbain. Elle entretient ainsi une mémoire gustative de la campagne vers les villes, consolidant ainsi un matrimoine gustatif transmis essentiellement par les femmes.
Aussi, sur le plan culturel, être restauratrice de rue, c’est comprendre la diversification des produits (mets traditionnels, boissons locales), conjuguée à une connaissance fine des goûts et des rythmes de vie urbains, tout en faisant preuve de flexibilité sur les prix des produits. C’est à ce titre une figure qui provoque de l’hybridation en introduisant dans le quotidien urbain des plats tels que le lalo (Artibonite), le tonm-tonm (Jérémie) et d’autres mets de l’arrière-pays. Par ce biais, elle participe à la transmission et à la transformation des patrimoines alimentaires haïtiens. Elle établit un point de contact entre le monde rural et le monde urbain en mobilisant le goût.
En outre, son espace de vente devient un point où s’active la convivialité dans le monde urbain. Dans un monde en expansion, la tonnelle de la restauratrice est un lieu de rencontre entre citadins partageant ou non une même condition sociale. Par son savoir-faire, elle favorise la circulation des traditions, renforce les liens communautaires et participe activement à la construction d’une identité urbaine plurielle. D’où aussi l’importance politique de la restauration de rue.
Sur le plan politique, la restauratrice de rue est au centre d’un écosystème social reposant sur un réseau complexe de relations, de motivations et d’actions qui, ensemble, façonnent la structure et la dynamique de la vie collective. Elle ne se contente pas de vendre de la nourriture ; elle participe à un réseau informel de soins et de solidarités quotidiennes. Inscrite dans des dynamiques de précarité, son activité offre un prisme original pour interroger la philosophie du care, valorisant la prise en charge des vulnérabilités humaines (Tronto, 1993).
La restauratrice de rue incarne une éthique du care pragmatique et communautaire, située à l’intersection des besoins matériels et relationnels des populations urbaines défavorisées. En reconnaissant cette dimension de son travail, on peut œuvrer à une meilleure inclusion de ces femmes et valoriser leur contribution pour penser la solidarité urbaine.
La restauration de rue assure aussi l’accès à la nourriture aux personnes du quartier souffrant de troubles mentaux ainsi qu’aux personnes âgées qui ne peuvent plus se prendre en charge. En pensant à ces individus, les restauratrices de rue proposent des formes de solidarité radicale allant à l’encontre des logiques de charité (tout bouch fanm pou manje). Ainsi, elles apportent des réponses face aux carences institutionnelles étatiques.
À côté de ces éléments, il convient aussi de noter que les restes ne sont pas jetés, mais utilisés pour nourrir les chiens errants des quartiers. Le geste de nourrir les chiens errants constitue une praxis de care multi-espèces reconnaissant la vulnérabilité partagée des humains et des non-humains, rompant avec l’anthropocentrisme dominant. Ces gestes s’inscrivent dans une politique par le bas, affirmant le droit à la prise en charge collective de la vie humaine et non humaine. Nourrir les chiens errants est une pratique subversive qui élargit les frontières de la solidarité et du soin, tout en proposant des pistes pour un engagement systémique vis-à-vis du vivant.
En conclusion, les restauratrices de rue incarnent une infrastructure sociale vitale, articulant subsistance, soin et transmission culturelle. Le travail des restauratrices de rue est encastré dans des relations sociales. Le propre de ce travail de subsistance est de travailler avec et pour les autres(Collectif Rosa Bonheur, 2019) ; ainsi, la restauration de rue semble se confondre avec la vie elle-même. Ce travail de subsistance permet de mettre en relation des activités disparates et pourtant toutes orientées vers la survie économique, matérielle et morale des habitant.e.s précaires de la ville (Collectif Rosa Bonheur, 2019).
Elles sont au centre d’une dynamique où les femmes structurent une économie de survie. Il en résulte que la restauration de rue fait de la ville un espace créateur de lien social et de solidarités, tout en suggérant des « pratiques de création du monde » (Kern, 2020, p. 57). Sans le proclamer, la restauration de rue réitère le droit à la ville pour les gens issus du « pays en dehors » et pour les femmes. En tant qu’espace de leadership féminin, cette sphère socio-économique assure le double rôle de nourrir les précaires dans la ville et d’assurer le maintien des liens entre les personnes issues de cette catégorie.
Reconnaître leur rôle revient à prendre au sérieux le care communautaire tout en valorisant les savoirs situés issus de l’entrepreneuriat informel féminin en Haïti. À travers ce prisme, la ville haïtienne se révèle non pas comme un chaos informel, mais comme un espace de coopérations complexes, avec entre autres en son centre ces actrices incontournables.
Soutenir les restauratrices de rue, c’est consolider la résilience urbaine et promouvoir une justice sociale enracinée dans les pratiques ordinaires du care, généralement assurées par les femmes. Elles assurent la mise en place, sans fanfare ni tambour, d’un réseau de care communautaire capable de répondre aux problèmes d’insécurité alimentaire, notamment en contexte de crise.
Elles sont les pivots sociaux d’une forme d’entraide sociale ancrée dans les dynamiques de vie des rues haïtiennes. En définitive, la restauratrice de rue est une figure hybride qui fait le pont entre le monde urbain et le monde rural par le déploiement de talents de négociatrice, de gardienne de mémoires, d’actrice économique et de caregiver communautaire.
Références
Collectif Rosa Bonheur, & Delfini, A. (2019, 30 septembre). Les classes populaires fabriquent la ville. Contretemps. https://www.contretemps.eu/classes-populaires-ville/
Collectif Rosa Bonheur. (2019). La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire. Paris : Éditions Amsterdam.
Kern, L. (2020). Feminist City: Claiming Space in a Man-Made World. Londres : Verso.
Tronto, J. C. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge.
[1] En dépit de son rôle essentiel dans le paysage urbain, il faut aussi noter que les problèmes d’hygiène, dans un contexte où le choléra est présent, constituent un élément à considérer lorsqu’on parle de la restauration de rue.
Dre Sabine Lamour est sociologue, professeure à l’Université d’État d’Haïti et professeure invitée à l’Université Brown. Titulaire d’un doctorat en sociologie de l’Université Paris 8 (2017), elle est spécialiste des féminismes décoloniaux, des dynamiques de genre et des mouvements féministes haïtiens. Ses recherches déconstruisent notamment le mythe de la Fanm Poto mitan et analysent les rapports de pouvoir en Haïti. Ancienne coordinatrice nationale de SOFA (2017-2022), elle contribue à mouka, une plateforme documentaire sur les droits des femmes haïtiennes. Elle a reçu en 2024 le prix Excellence in Scholarship Award de la Haitian Studies Association.
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 54 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
de Malek Fouda
08/01/2026 - 11:06
By Josiah St. Luce
25/12/2025 - 09:51
Commentaires récents
Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
Albè vous avez ...
Frédéric C.
12/01/2026 - 12:06
...oublié l’Atoumo, je crouwaaah ha ha?... Lire la suite
Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
MARRE ?
Albè
11/01/2026 - 18:39
Toi "en avoir marre" ? Laisse-moi rire ! Lire la suite
Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
Dis papa ,..c'est quoi un "esprit malade" ?
tim
11/01/2026 - 13:28
Cas d'école presque trop facile à résoudre ...je vais finir par en avoir marre ..pas assez diffi Lire la suite
Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
DE GAUCHE OU DE DROITE ???
Albè
11/01/2026 - 12:29
L'esprit malade est celui qui croit qu'il existe des "indépendantistes de droite ou de gauche" en Lire la suite
Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
DEVOIR D'INCOHERENCE
abcx
11/01/2026 - 10:51
Les indépendantistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, souscrivent au devoir d'incohérence. Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Ces fachos ne connaissent même pas la géographie !
- Trump : "Est il normal que deux îles situées au pied de l'Amérique, ainsi qu'une portion de l'Amérique latine toute proche du Vénézuela, soient administrées par un État européen ?"
- Réplique d’Olivier Fanon à une chronique de Kamel Daoud
- Ki sa zot kay fouté nan péyi moun-lan ?
- 2026 pou sèvi lakoz lanng kréyol-la tou.
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus