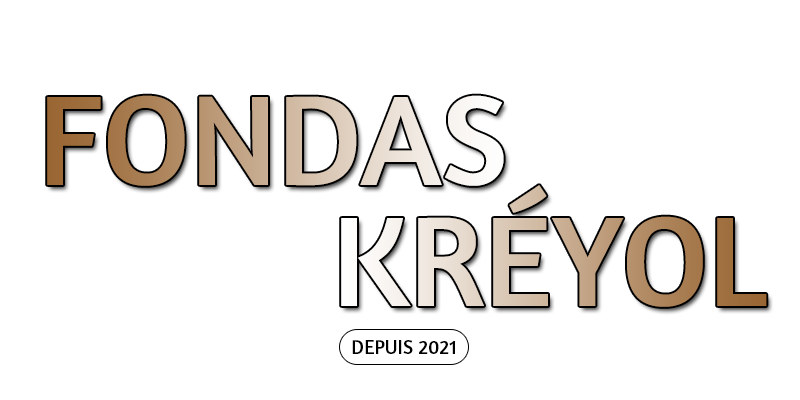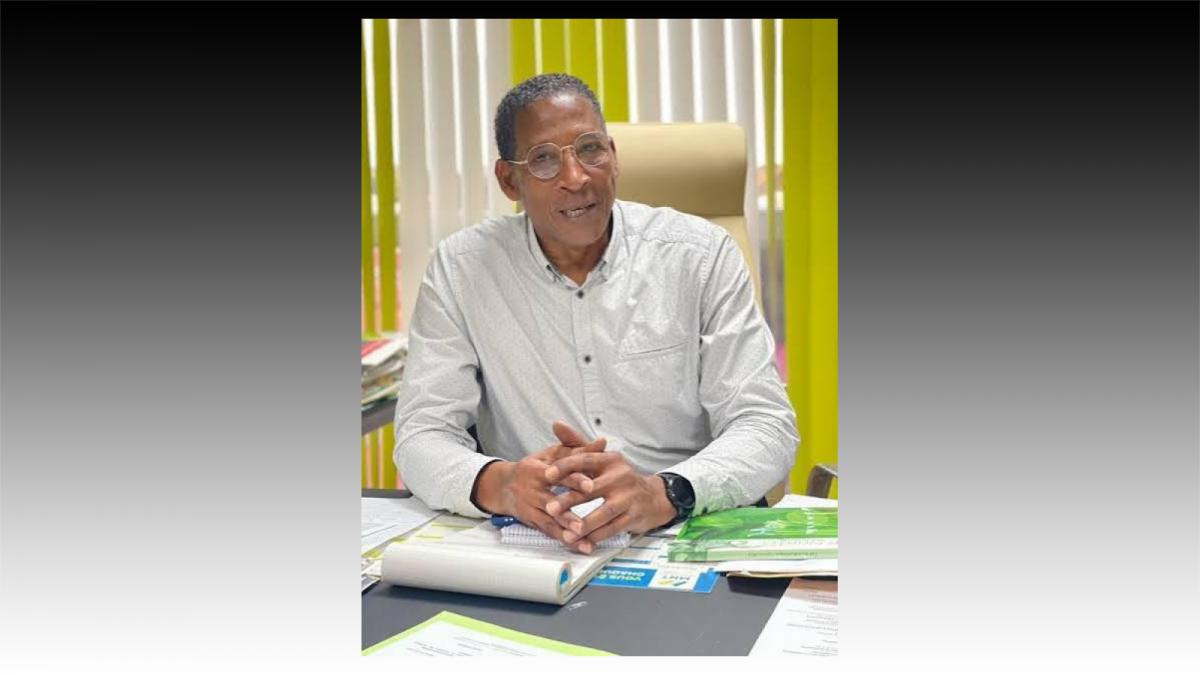La stérilisation forcée des Réunionnaise : Un crime d’État colonial occulté

On a trop longtemps parlé de “maladresse médicale” ou de “dérive administrative”. Il n’en est rien. Ce qui s’est joué à La Réunion dans les années 1960 et 1970 relève d’un crime d’État, pensé et couvert par les gouvernements français de l’époque. Derrière les slogans sur la lutte contre la misère et le contrôle démographique, il y avait un projet clair : réduire le nombre de naissances sur l’île, discipliner les ventres des femmes réunionnaises, les soumettre à une logique coloniale de gestion des corps. Dans ce contexte, des milliers de femmes ont été avortées de force ou stérilisées à leur insu, parfois même sous prétexte d’appendicite, parfois alors qu’elles étaient enceintes de six ou sept mois.
La clinique orthopédique de Saint-Benoît, dirigée par le docteur David Moreau, fut l’un des lieux emblématiques de ce désastre. Là, on opérait des femmes sans leur consentement, on stérilisait à la chaîne en maquillant les actes pour que la Sécurité sociale rembourse, et l’on avortait dans des conditions indignes. C’est à la suite d’une plainte déposée en 1970 par le docteur Roger Serveaux, qui dénonçait les mutilations infligées à une jeune patiente, que la lumière commença à percer. Le procès qui s’ensuivit, en février 1971, vit comparaître plusieurs médecins et un infirmier. Certains furent condamnés, mais les peines restèrent dérisoires et les principaux responsables, comme Moreau, purent poursuivre leur vie sans jamais être inquiétés. Le plus ignoble fut que les victimes, en plus d’avoir été trompées et mutilées, durent supporter le poids des frais de justice.
La défense des praticiens, telle que relayée dans la presse nationale, dévoile la profondeur du scandale. Le docteur Ladjadj, l’un des accusés, affirmait sans détour que la Sécurité sociale et le président du conseil général lui avaient donné le feu vert pour les stérilisations. Ce n’était pas une initiative isolée, mais bien un système organisé et couvert par les institutions locales et nationales. L’administration préfectorale savait. Les ministres à Paris savaient. Les élus réunionnais, obsédés par l’idée de modernisation et de soumission à l’État central, savaient. Et tous ont choisi de fermer les yeux.
C’est dans ce contexte qu’émergea la figure des “30 courageuses”, ces femmes qui osèrent déposer plainte et parler haut, malgré les pressions et la stigmatisation. Elles furent insultées, isolées, réduites au silence par une société qui préférait oublier. Mais leur geste brisa un mur de silence et transmit une mémoire qu’aucune falsification ne pourra effacer. Solange, fille de l’une d’entre elles, raconte encore aujourd’hui la brutalité du geste qui marqua sa mère : elle était partie consulter pour une grossesse, elle revint mutilée, avortée et stérilisée sans même avoir été informée. Ces récits bouleversent par leur force et rappellent que derrière les dossiers médicaux se trouvent des vies détruites, des lignées interrompues, des familles meurtries.
Ce qui s’est passé à La Réunion n’est pas un cas isolé. Dans les Antilles, en Guyane, en Polynésie, la même logique fut appliquée. Le corps des femmes ultramarines était considéré comme un problème à régler, comme une menace à neutraliser. La politique du BUMIDOM, orchestrée par Michel Debré, complétait le dispositif : d’un côté on stérilisait, de l’autre on déportait les jeunes vers l’Hexagone. Le projet colonial poursuivait sa marche après 1946, déguisé derrière les discours républicains.
Or ce crime n’a jamais été réparé. L’État n’a jamais reconnu sa responsabilité pleine et entière. Aucune commission vérité n’a vu le jour. Aucune archive n’a été ouverte en totalité. Aucune indemnisation n’a été versée. Les médecins ont fini leur carrière honorés. Les responsables politiques ont terminé leurs mandats sans jamais être inquiétés. Et les victimes, elles, n’ont eu droit qu’à l’oubli, à la honte imposée et au silence.
Il faut aujourd’hui que la vérité éclate et qu’elle soit dite avec force : les stérilisations forcées des Réunionnaises furent une politique coloniale, raciste et criminelle, menée au nom de l’État français. Ce fut une mutilation collective infligée à un peuple, une tentative de briser son avenir dans la chair même des femmes qui le portent. Tant que ce crime restera nié, tant que les coupables resteront protégés par le silence, tant que la France se contentera de phrases creuses, aucune réconciliation ne sera possible.
La Réunion porte dans ses entrailles cette blessure. Et si l’État français refuse toujours de la reconnaître, alors il faudra le dire haut et fort : un pays qui mutile les ventres de ses femmes n’a aucune légitimité à se proclamer patrie des droits de l’homme. L’heure n’est plus aux excuses feutrées mais à la justice concrète. Ce crime exige la création d’une commission vérité indépendante, l’ouverture complète des archives, l’audition publique des victimes et la condamnation symbolique mais ferme des institutions qui ont couvert ces actes. Il exige aussi des réparations, financières et mémorielles, car sans réparation il n’y a pas de justice, et sans justice il n’y a pas de paix.
Si cette exigence continue d’être ignorée, alors l’histoire jugera. Et elle jugera durement, car un État qui efface ses crimes est un État qui prépare ses violences futures. La Réunion, comme tous les territoires meurtris par l’arrogance coloniale, ne peut plus attendre. La vérité doit surgir, la mémoire doit s’imposer, et la justice doit frapper. Car un peuple dont on a tenté de mutiler les mères ne pardonnera jamais tant que le crime n’aura pas été reconnu et réparé.
« L’histoire est faite de ce qu’on cache autant que de ce qu’on dit. » – Édouard Glissant
Patrice Sadeyen
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 256 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Dorothy Bonnefemme ("Topfm.mu")
25/01/2026 - 19:37
Angelica Paredes Lopez (radiorebelde.cu)
16/01/2026 - 11:42
Commentaires récents
S'amuser à se faire peur pour rien...
INCAPABLE...
Albè
05/02/2026 - 16:45
...de coloniser le Canada ou le Groënland, territoires remplis de richesses minières, Trump songe Lire la suite
S'amuser à se faire peur pour rien...
Comment pouvez vous affirmer...
Frédéric C.
05/02/2026 - 14:17
...avec certitude que Trump-2 ignore l’existence même de nos pays ? Lire la suite
Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault
Je précise ma pensée :
yug
05/02/2026 - 12:46
Accuser: Présenter qq'un comme coupable (Larousse)
Lire la suiteSaint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault
POVRE CONARD, VA !
Albè
05/02/2026 - 11:00
Donc les articles du communiste-autonomiste Michel Branchi et de l'indépendantiste-CNCP Robert Sa Lire la suite
Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault
Vidéo-tract électoral
yug
05/02/2026 - 10:40
Je me fous des départementalises ,de Branchi ou du CNCP..Ce que je sais c'est que cet "ARTICLE" e Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- La ministre des Outremers dénonce le racisme...anti-blanc
- L'île paradisiaque dont les habitants n'ont pas le droit d'utiliser les plages
- Il devrait prendre des cours d'...anglais !
- Hilarante campagne électorale dans l'île aux fleurs fanées
- D'où l'expression "saoul comme un Polonais"...
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus